

En lisant les réflexions de théologiens de la mouvance libérale, je me pose souvent la question de leur rapport à la Bible. Je me demande quelle sorte de réalité elle est pour eux, comment ils la considèrent et la pratiquent pour tirer d’elle tel ou tel message. Pour ma part, je propose à ce sujet les quelques réflexions qui suivent. Il est possible qu’on y voie l’expression d’un biblicisme échevelé mais j’aimerais pourtant qu’elles puissent apporter une clarification, et susciter aussi une extrême liberté dans l’exploitation des Écritures. Tel est mon propos, et je ne demande pas mieux que d’en discuter la pertinence.
Mon point de vue est le suivant : la Bible tout entière n’est, ni un ensemble de mythes ou de légendes comme certains le disent, ni la Parole de Dieu comme d’autres l’affirment, mais une grande, complexe et signifiante parabole.
Encore faut-il que j’expose ce que j’entends par là car le lecteur pourrait comprendre à tort que, pour moi, ce que la Bible raconte est faux. Ce faisant, je vais sans doute insister parfois sur des évidences : je l’assume, pour avoir eu souvent l’expérience que dès que la religion s’en mêle, ce que l’on tient habituellement pour évident peut se trouver occulté…
Le langage est l’un des moyens que l’être humain s’est donné pour communiquer des informations et du sens à l’aide d’éléments fort divers, mais en l’occurrence, avec la parabole il s’agit des éléments de la parole, serait-elle écrite. Je rappelle que, de même que le tableau de Magritte représentant une pipe n’est pas une pipe, ou que le mot couteau, par exemple, n’est pas un couteau, le langage n’est pas de même nature que ce dont il parle. Nos outils et nos éléments de parole ont pour point commun, entre autres, qu’ils ne doivent pas être confondus avec les réalités que l’on nomme leur référent : ce à quoi ils se réfèrent et qu’ils ont pour but de signifier, de faire connaître. Ce que je dis en affirmant que la Bible est une parabole, c’est donc qu’elle ne doit pas être confondue avec ce qu’elle vise à communiquer, à faire connaître, à signifier.
Ainsi, il est clair qu’elle vise – disons pour parler vite – à signifier la relation du divin et de notre monde : Dieu et nous. Or je n’ai bénéficié personnellement d’aucun contact direct avec le divin, du moins à ma connaissance, ceci même en lisant la Bible ! Le divin dont j’ai connaissance et sur lequel je m’appuie, sur lequel je fais fond, m’a néanmoins été signifié par celleci ou par des gens qui l’avaient lue.
Un premier point est donc que le dieu de la Bible n’est pas dans la Bible, mais que celle-ci le signifie. Plus : le dieu qui figure dans la Bible est un personnage littéraire dû à l’art de ceux qui en ont écrit. C’est pourquoi, comme l’écrivait naguère le professeur Frank Michaëli, il est un « Dieu à l’image de l’homme ». Un personnage assez multiple dans ses diverses apparitions littéraires, et selon les multiples aventures qui y sont les siennes, pour qu’il puisse évoquer, signifier, le Dieu tout-autre qu’aucun de nous n’a jamais vu.
Prenons comme exemple un récit que tout le monde s’accorde à appeler parabole, l’histoire du fils prodigue et du fils obéissant (Lc 15,11-32). Il y apparaît clairement que, au-delà du récit proprement dit, ce sont certaines relations entre Dieu et les êtres humains qui sont signifiées. Néanmoins, Dieu n’est évidemment pas le père des humains au sens où le père de la parabole est le géniteur de ses deux fils.
Il en va de même pour l’ensemble des éléments que l’on trouve dans les Écritures. Ce sont des écrits. C’est de l’encre sur du papier. Voudrait-on même que cela devienne parole qu’il y faudrait un lecteur pourvu d’une voix et d’un souffle.
En second lieu, la parabole est un récit, mais sa spécificité, par rapport à d’autres types de récits, est radicale, ceci au point que l’on en est presque venu à n’employer ce terme de parabole que dans le cadre de la littérature liée à la Bible.
Bien sûr, il s’agit d’une évidence, la parabole raconte une histoire. Elle a ce point commun avec d’autres genres littéraires anciens comme le mythe, le conte ou la légende. Mais si elle est un récit, elle n’est pas totalement compréhensible pour le lecteur ou l’auditeur. Car si, la plupart du temps, le fil du récit est facile à comprendre, le lien qu’elle entretient avec ce à quoi elle se réfère, avec ce qu’elle semble vouloir signifier, n’est pas évident. Autrement dit, si l’on comprend bien ce qu’elle raconte, on ne saisit pas toujours pourquoi elle le fait, ou, si l’on préfère, de quoi elle parle. À ce sujet, on est souvent ramené d’une manière ou d’une autre à ceci : « Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » (Mc 4,23).
D’ailleurs, dans le récit même des évangiles, on voit que les paraboles ne visent pas à donner une impression de clarté et de facilité. Ce qu’on y lit, c’est, suivant les cas, ou bien que les savants comprennent aussi mal les paraboles que les ignorants, ou bien que les ignorants comprennent aussi bien les paraboles que les savants.
Je m’explique : il y a deux situations possibles. Dans la première, on a affaire à des gens qui, ignorants ou savants, sont en demande, et donc en recherche. Dans ce cas, les savants peuvent avoir plus de mal dans leur démarche. Peut-être parce qu’ils ont à lutter contre l’ensemble des implications de leur savoir, ou parce que leur recherche elle-même est obérée par le sentiment d’être des importants ?
Dans la seconde, on a affaire à des gens qui ne sont pas en recherche, et dans ce cas l’incompréhension est également répartie entre savants et ignorants.
Le premier cas peut être illustré par cette parole dite à Nicodème : « Tu es le docteur d’Israël et tu ne sais pas ces choses ! » (Jn 3,10). Cette parole est dite après la petite parabole du verset 8 : « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. »
Le second cas est illustré par la parabole du semeur. Dans Marc (4,3-20), cette parabole suscite l’incompréhension générale, de la foule comme des disciples. C’est que, dans cet évangile, les disciples ne sont pas meilleurs « compreneurs » que les autres. Dans Matthieu (13,4-23), au contraire, les disciples sont en situation de comprendre, mais pas la foule, et Jésus y résume la situation en ces mots : « On donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a. »
Sans l’ouverture d’un questionnement vital, d’une ouverture, d’une demande, d’un désir, la parabole ne parle pas chez celui à qui elle est adressée.
Cet exemple de la parabole du semeur vaut sur un plan plus général. Tous les auditeurs y ont manifestement bien suivi le récit des aventures de la semence, mais personne ne semble avoir compris à quoi il se référait. Pourquoi donc Jésus raconte-t-il cette histoire ? Pour que seuls ceux qui cherchent vraiment une réponse la trouvent. Autrement dit, en mettant en recherche son auditeur, la parabole vise à faire de lui… la bonne terre où la parole porte du fruit ! Quel fruit ? De quelle sorte ? Il n’est pas important de le préciser. Ce qui est important, c’est la mise en route de l’auditeur qui était en demande. C’est ce que la parabole peut faire.
On risque de voir là une illustration de ce que les spécialistes du langage appellent un discours performatif, c’est-à-dire un langage qui fait ce qu’il dit, comme lorsque l’on dit « La séance est ouverte ! », mais il n’en est rien. La parabole ne fait pas ce qu’elle dit, elle le faitfaire, ou plutôt elle le fait venir et, dans une certaine mesure, inventer, créer. Elle ouvre une histoire possible pour qui l’entend avec de vraies oreilles.
Je tire de cet exemple l’extrapolation suivante, que j’érige en définition : la parabole est ce récit qui vise à faire venir ce qu’il parle, alors même qu’il ne dit pas ce dont il parle.
Ainsi, et c’est fondamental, en affirmant que la Bible appartient à ce genre littéraire que j’appelle parabole, je pose qu’elle ne dit pas Dieu dans son être, mais qu’elle vise à le faire venir, à sa manière, au coeur de l’être humain et de l’humanité.
 J’insisterai ensuite sur le fait que la parabole peut se composer d’éléments narratifs fort divers, dont certains peuvent se rapporter à des faits réels, voire historiques, et dont la plupart sont liés au contexte (culturel, social, économique, politique) dans lequel elle est née. Tout n’est donc pas inventé, imaginé, bien loin de là ! Et tout n’est pas purement et simplement narratif.
J’insisterai ensuite sur le fait que la parabole peut se composer d’éléments narratifs fort divers, dont certains peuvent se rapporter à des faits réels, voire historiques, et dont la plupart sont liés au contexte (culturel, social, économique, politique) dans lequel elle est née. Tout n’est donc pas inventé, imaginé, bien loin de là ! Et tout n’est pas purement et simplement narratif.
Mais s’il n’y a pas que du récit dans la parabole, si l’on peut également y trouver des éléments appartenant à d’autres genres littéraires, ces éléments sont inclus dans le cadre général de la narration. C’est en fonction de celle-ci qu’ils prennent leur sens, les uns comme les autres étant subordonnés au mode général de la parabole. C’est elle qui est importante. C’est elle qui qualifie chacun des éléments qui la constituent en traits cohérents et significatifs de son économie générale.
Ainsi en est-il par exemple de la parabole des Vignerons homicides (Mt 21,33-44 et récits parallèles), qui comprend la citation de deux textes du Premier Testament, un oracle prophétique (« Il sera une pierre d’achoppement, un rocher de scandale », Es 8,14) et l’extrait d’un psaume (« La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l’angle », Ps 118,22). Bien que non narratifs, ces deux éléments littéraires sont pourtant devenus des parties constitutives de la parabole racontée.
On peut trouver cela en beaucoup plus ample dans la parabole du pauvre Lazare (Lc 16,19-31) : non seulement on y trouve Abraham, mais surtout on y est renvoyé à presque toute la Bible hébraïque : « Ils ont Moïse et les Prophètes, qu’ils les écoutent. » On voit qu’ici, ce qui est inclus dans la parabole rassemble, serait-ce sur le mode de l’évocation, des textes législatifs et prophétiques tout autant que narratifs. Et non seulement elle les évoque, mais elle renvoie le public à leur contenu en sorte que leur oubli ne permettrait pas de comprendre et recevoir la parabole : ils font partie d’elle.
Je note alors que l’on peut justement raconter toute la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse. C’est d’ailleurs une de ses spécificités, qui la distingue par exemple du Coran. Mais au cours de la narration, il sera nécessaire de faire intervenir dans le récit des éléments non narratifs : poétiques, légaux, sapientiels, historiques, etc.
Il est plus difficile de trouver un exemple de faits historiques dans les paraboles évangéliques. Toutefois, on remarquera qu’elles contiennent nombre d’éléments de nature historique, tout inventées qu’elles aient été. Ainsi, les évangiles n’inventent pas, par exemple, le fait que les ouvriers agricoles palestiniens de l’époque romaine attendaient le matin en un lieu dit que les sbires des propriétaires terriens viennent les engager pour la journée (Mt 20,1-16). Ce fait était dû à l’une des conséquences de la colonisation, créatrice d’un système d’exploitation agricole dans lequel les petits paysans étaient dépossédés de leur terre et devenaient des prolétaires.
Mais ce que ce point suppose va beaucoup plus loin. Il permet de rendre compte du fait que des récits inventés comme ceux de Job, d’Esther ou de Jonas aient été mis sur le même plan, dans la Bible, que les récits plus ou moins historiques qu’on peut trouver par exemple dans les Chroniques. Inversement, il permet aussi de comprendre que certains événements historiques aient pu revêtir une valeur parabolique.
Et c’est sur ce mode que l’expérience humaine, existentielle, des divers protagonistes va prendre sens. Je m’explique : la Bible comprend aussi des récits qui rapportent les dits et les gestes d’hommes et de femmes qui ont voulu, ou bien voulu, pour le dire ainsi de façon parabolique, figurer dans la parabole. Cela va de soi à partir du moment où l’on accepte l’idée que l’ensemble de leur existence était, selon eux, déjà signifiée dans l’aire de la grande parabole biblique, et pourvue de sens en fonction du seul point de vue de celle-ci. Entre autres, tels sont les prophètes.
Ainsi certains prennent-ils place tout naturellement dans la narration qui est en train de s’élaborer au cours des siècles. C’est ce qu’on appelle faire l’histoire ! D’autres le voudraient qui n’y parviennent pas, et qu’on appelle par exemple faux prophètes. Ceux-là n’ont pas saisi le mode d’agir de la parabole, mode qui ne fait qu’un avec son sens.
Dans la mesure où la parabole fait venir ce qu’elle dit, ou plutôt ce qu’elle parle, ce qu’elle instaure par son langage, on peut, je pense, parfaitement comprendre cette inclusion de la chair et des os, d’histoires personnelles ou collectives, dans l’élaboration du récit. C’est ce que, dans un langage différent qui verse trop facilement dans le dualisme de l’âme et du corps, on a appelé incarnation. C’est en tout cas ce qui la distingue absolument du mythe, de la légende ou du conte, dont personne n’a jamais désiré, sauf à l’occasion par jeu, devenir membre actif !
C’est ainsi que même un peuple a pu se constituer en tant que protagoniste du récit biblique, non seulement en parole mais à grand renfort de sperme et d’ovulations, de sueur et de sang.
C’est également ainsi que, de l’homme Jésus, « l’esprit » du récit ait pu dire : « Celui-ci est mon fils », reprenant ainsi la thématique ancienne du lien paternel que Dieu était censé établir avec le roi d’Israël (Ps 2,7 repris par Mt 3,17 et textes parallèles). Ce que j’appelle ici l’esprit – l’Esprit – est une façon de percevoir l’ensemble des implications de cette histoire en tant qu’elle signifie la possibilité d’une relation positive des humains avec Dieu. Une histoire à faire pourra s’ensuivre alors.
C’est donc ainsi que des millions d’humains ont pu se dire fils de l’un des personnages-clés de la parabole, Abraham, ou soumis, avec Moïse, à la Loi du Seigneur de la parabole, ou bien d’autres, encore, se sentir enfants du Père de la parabole, disciples et amis du Fils de la parabole, animés et consolés par l’Esprit de la parabole. Cette parabole qui signifie précisément le lien qui unit le divin au monde de nos perceptions. Le signifie, et le qualifie finalement comme un lien d’amour unilatéral et premier.
 La parabole biblique se limite donc à un certain type de langage humain dans le but de signifier ce qui n’est pas de l’ordre du langage humain. En le faisant, elle pose tout simplement que sortir de ce type de langage, de ce mode, tout en gardant la même intention serait impossible. C’est une loi connue de tout artisan du langage : quand il s’agit de création littéraire, on ne dit pas la même chose quand on la dit autrement. Il est donc posé que cette réalité qui n’est pas de l’ordre du langage humain est indicible… sauf à recourir au langage parabolique. En termes plus simples : le Dieu dont parle la Bible, le Dieu que la Bible parle, est le Dieu…biblique.
La parabole biblique se limite donc à un certain type de langage humain dans le but de signifier ce qui n’est pas de l’ordre du langage humain. En le faisant, elle pose tout simplement que sortir de ce type de langage, de ce mode, tout en gardant la même intention serait impossible. C’est une loi connue de tout artisan du langage : quand il s’agit de création littéraire, on ne dit pas la même chose quand on la dit autrement. Il est donc posé que cette réalité qui n’est pas de l’ordre du langage humain est indicible… sauf à recourir au langage parabolique. En termes plus simples : le Dieu dont parle la Bible, le Dieu que la Bible parle, est le Dieu…biblique.
Elle en dit long, ainsi, à qui est en recherche. Elle lui dit : « Quant à Dieu lui-même, en son Être, sache que la seule chose qui lui importe, c’est que tu entres dans la parabole comme l’un de ses protagonistes, car lorsqu’on parle de Dieu, dans ces Écritures, c’est de ton histoire à toi qu’il est question. » Tant il est vrai que ce qui est important avant tout dans le Livre, « ce n’est pas ce qu’il dit, mais ce qu’il fait et fait faire », comme l’écrivait le philosophe Jean-François Lyotard (1924-1998) à propos des livres en général.
Mais si la Bible se limite à son mode parabolique pour signifier le divin, cela implique que l’on devra se contenter absolument de cette limitation, autorisé et poussé que l’on est alors à créer librement du neuf à partir de la vieille parabole. Il y a là un arbitraire en dehors duquel on n’est plus dans l’aire biblique, dans la foi biblique. La chose est semblable à un jeu de société : si l’on change l’arbitraire de la règle, on change le jeu, à moins qu’on ne le détruise.
Cette limitation, qui permet la signification du message, est la source première de cette autre limite qu’est le canon biblique, c’est-à-dire la liste et le contenu des livres qui composent la Bible. De même, elle représente l’origine et la légitimation de la fixation arbitraire des textes par certaines communautés humaines – Synagogue et Églises. Cette fixation est dite arbitraire, non au sens où elle se serait opérée par oukase et caprice, mais au sens où elle c onstitue une règle du jeu.
D’où la nécessité d’un littéralisme qui n’est pas un fondamentalisme, tout au contraire, mais qui consiste en une règle de lecture que les croyants s’accordent à respecter ensemble afin d’en tirer librement ce qu’illeur importe d’en tirer pour mieux vivre.
Un corollaire de cela est que ce ne sont pas les résultats scientifiques de la recherche biblique qui concernent en premier lieu les croyants, même s’ils peuvent et doivent l’éclairer dans la libre exploitation qu’ils feront ultérieurement de leur lecture. Il s’agit en effet de voir en celle-ci un rapport direct, collectif de préférence, avec les Écritures. Car, telle cette Jérusalem « dont toutes les parties vont ensemble » (Ps 122,3), elles sont en elles-mêmes une oeuvre littéraire concertée.
Les Écritures ne sont, ni la somme des bribes d’information antérieures à leur fixation récoltées par les spécialistes, ni le fonctionnement des structures sousjacentes que d’autres ont mis au jour, ni l’une ou l’autre des reconstructions que les uns ou les autres auront élaborées, ni la suite de leurs versets envisagés comme des règles à s’imposer à soi-même et encore moins aux autres.
Être dans la foi biblique, la foi d’Abraham, de Moïse, de David et de Jérémie, la foi de Jésus, c’est se situer dans la parabole biblique et jouer son jeu.
 Ces réflexions comportent une conséquence quant au langage que l’on peut tenir pour désigner la Bible. Si elle est une parabole, elle n’est pas la Parole de Dieu, elle signifie celle-ci. Elle le fait par les moyens pratiques de l’écriture. C’est pourquoi il vaut mieux, pour les croyants, dire « Écritures saintes » plutôt que « Parole de Dieu ».
Ces réflexions comportent une conséquence quant au langage que l’on peut tenir pour désigner la Bible. Si elle est une parabole, elle n’est pas la Parole de Dieu, elle signifie celle-ci. Elle le fait par les moyens pratiques de l’écriture. C’est pourquoi il vaut mieux, pour les croyants, dire « Écritures saintes » plutôt que « Parole de Dieu ».
Lorsque, d’écritures, les éléments bibliques deviennent paroles, c’est-à-dire lorsqu’ils sont portés par la voix, le souffle, la présence, l’action ou encore les institutions d’êtres humains vivants, il se peut alors qu’on assiste à l’éclosion d’une Parole de Dieu. Mais il ne faut pas confondre les choses : une parole est une parole, une écriture est une écriture. La confusion dans le langage entraîne celle des esprits, des actions et des institutions.
Il n’est pas de notre ressort de savoir par quels moyens il se trouve que les Écritures saintes sont en mesure de signifier ce qui vient de Dieu. C’est juste affaire de foi, c’est-à-dire de confiance absolue en cet arbitraire. En chacun de nous, l’origine de cette confiance, si elle a affaire avec l’Esprit de la parabole dont je parlais, reste pourtant un mystère caché en Dieu. Mais pour ce qui nous concerne hic et nunc, il est de notre responsabilité de croyants de faire éclore la Parole de Dieu à partir des Écritures.
« Mettre la Parole de Dieu en pratique » ne signi-fie pas obéir aux diverses injonctions que l’on pourra trouver dans la Bible, mais pratiquer celle-ci, c’est-àdire faire d’elle, en pratique, une Parole vivante, créer de la vie qui puisse coïncider avec la Grande parabole de l’amour de Dieu. Certes, cela se fait, dit-on traditionnellement, grâce à l’action du Saint-Esprit. Mais cet Esprit, pour nous, c’est celui des Écritures… C’est ce que la pratique des Écritures crée en nous, et non une sorte d’ectoplasme, qu’il soit de nature mentale ou émotionnelle, surgissant des limbes pour nous dicter notre lecture. C’est le souffle – comme on dit « avoir du souffle » – qui vous pousse à adhérer à cette histoire et à y entrer. Esprit et souffle sont d’ailleurs un même mot dans chacune des deux langues bibliques.
C’est pourquoi le premier programme du croyant est de lire les Écritures. C’est son premier service. C’est ainsi qu’il s’imprègnera de leur Esprit. Qu’il deviendra instrument de cet Esprit pour parler, agir, se comporter selon l’Esprit. Pour faire parler, agir, venir, la Parole.
On voit que pour moi la Parole de Dieu n’est pas antérieure aux Écritures, mais postérieure… et aléatoire.
Si on la dépouille des diverses institutions dont elle s’est dotée au cours de son histoire, ce qui reste de la communauté des croyants c’est qu’elle se fonde en pratique sur une communauté de lecture, sur un pacte de lecteurs. La mise en oeuvre de ce pacte a connu bien des avatars, subi bien des avanies. Il n’est pas certain que cette Parole de Dieu soit seulement perçue comme telle. Néanmoins elle est là, au début de notre pratique. Et elle est toujours à réformer.
Dans la ligne, précisément, de la Réforme, elle est à démocratiser. J’utilise ce terme dans l’aire d’une pratique très précise : celle de l’exercice commun, communautaire, populaire, échangiste et critique de ce travail-combat-plaisir qui consiste à faire naître une Parole des Écritures. Parole de vie.
Il est possible qu’une telle entreprise puisse rendre au peuple protestant le goût pour la lecture de la Bible qu’il a manifestement perdu.
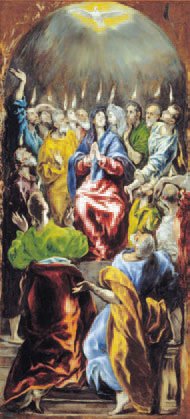 Il s’agit donc de voir en la Bible une parabole. Un récit qui vise à faire venir ce qu’il parle chez son auditeur. Il me semble que voir les choses ainsi, c’est permettre aussi de dépasser de vieilles oppositions de doctrine portant sur le mode de réception des Écritures. Ces débats me paraissent liés à des conceptions dont le point de départ est toujours un dualisme de la forme et du fond, affirmation qui supposerait un autre exposé. Dominikos Theotokopoulos, dit Le Greco, La Pentecôte. (ca. 1600) Madrid, Musée du Prado
Il s’agit donc de voir en la Bible une parabole. Un récit qui vise à faire venir ce qu’il parle chez son auditeur. Il me semble que voir les choses ainsi, c’est permettre aussi de dépasser de vieilles oppositions de doctrine portant sur le mode de réception des Écritures. Ces débats me paraissent liés à des conceptions dont le point de départ est toujours un dualisme de la forme et du fond, affirmation qui supposerait un autre exposé. Dominikos Theotokopoulos, dit Le Greco, La Pentecôte. (ca. 1600) Madrid, Musée du Prado
Or la parabole ne sépare pas la forme du fond, son mode fait partie de son sens et inversement.
Mais là n’est pas le point fondamental, qui touche plus profond :
Je crois en Dieu, non en la Bible, néanmoins je ne connais Dieu que par la Bible.
C’est du moins ce que j’affirme, même lorsque la réalité d’autres moyens de connaissance du divin m’est opposée ou proposée. Je suis dans cet arbitraire, parce que c’est pour moi la condition très pratique pour faire l’amour de Dieu. Du Dieu que j’aime.
Pour les Réformateurs du XVIe siècle, l’enjeu était de permettre à tous d’avoir accès directement au Salut de Dieu offert en Jésus- Christ. La Réforme était la conséquence d’une intériorisation radicale de Pâques. Aujourd’hui, l’enjeu pourrait être de permettre à tous de faire vivre l’Esprit, et de devenir ainsi metteurs en oeuvre de ce salut opéré une fois pour toutes. Il s’agirait d’une intériorisation radicale et collective de Pentecôte.
Peut-être qu’alors, les protestants, libérés de l’ancienne nécessité de prendre les Écritures comme un mode d’emploi au lieu d’un filon à faire produire, recommenceront-ils à lire la Bible ?
Pour faire un don, suivez ce lien
 Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté
Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté
