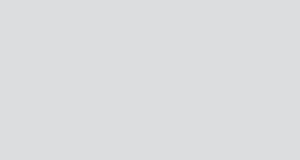On insiste souvent sur l’importance de la parole dans la tradition protestante et sur sa méfiance à l’égard du visuel et des images. Le protestantisme manque aussi de visibilité. Or je suis intéressé par le fait que la Réforme protestante est marquée, à son origine, par deux gestes très voyants, ostensibles et décisifs.
On insiste souvent sur l’importance de la parole dans la tradition protestante et sur sa méfiance à l’égard du visuel et des images. Le protestantisme manque aussi de visibilité. Or je suis intéressé par le fait que la Réforme protestante est marquée, à son origine, par deux gestes très voyants, ostensibles et décisifs.
Le premier geste
Nous allons fêter, à partir de janvier 2017, le 500e anniversaire de la Réforme. Pourquoi cette date ? On le sait, il s’agit de célébrer le fameux affichage des 95 thèses (écrites d’abord en latin) de Luther le 31 octobre 1517 à la porte de l’église du château de Wittenberg. Les indulgences, alors vendues par et pour l’Église romaine, assuraient au fidèle la remise de peines dues à certains péchés. Luther, à travers ses 95 thèses, a proclamé le salut par la seule grâce de Dieu (sola gratia) et s’est ainsi élevé contre une pratique, toujours en usage aujourd’hui, mais non plus monnayée. Ce début de l’histoire protestante a déterminé la date de la Fête de la Réformation fixée le plus souvent le dernier dimanche d’octobre ou le premier dimanche de novembre et centrée sur la proclamation du sola gratia.
Ce geste emblématique d’un affichage a assurément un caractère inaugural ; il est d’ailleurs plus positif que négatif. Luther, en effet, ne pensait pas encore à une rupture avec Rome. Le caractère subversif de cet affichage était en effet limité par la conviction du Réformateur selon lequel ces thèses étaient conformes à l’enseignement véritable, fondamental et premier d’une l’Église susceptible de se réformer.
Le second geste
Il en va tout autrement d’un deuxième geste d’ordre éminemment visuel et tout à fait spectaculaire : le11 décembre 1520, on allume, toujours à Wittenberg, un bûcher où sont brûlés, entre autres, un exemplaire du droit canon de l’Église et la bulle pontificale (lettre avec le sceau du pape) que Luther jette dans les flammes. La bulle lui ordonnait de se rétracter sous peine d’être excommunié, ce qui sera bientôt fait. Ce geste est, lui, clairement celui d’une rupture avec Rome et ses autorités, tout un système hiérarchique et monarchique. C’est un geste d’insoumission et de divorce total. Certains catholiques estiment que c’est ce geste-là qui marque vraiment le début du protestantisme et que c’est à lui que nous devrions nous attacher pour une Fête de la Réformation. Le caractère très négatif de ce geste, un autodafé, explique probablement le fait qu’on lui ait préféré l’affichage premier, plus affirmatif, et, à certains égards, plus fondamentalement théologique.
Sans vouloir grossir l’importance visuelle de ces deux gestes, je reste cependant impressionné par leur marque propre à frapper les regards. Le protestantisme souffre de non-visibilité. C’est là un handicap dans une civilisation de l’image si prégnante aujourd’hui, surtout avec le rôle de la télévision. Cela fait partie de la précarité protestante, pour reprendre une expression du sociologue Jean-Paul Willaime. Alors, quels gestes pour demain ?
Cela dit, avec le pape, avec Rome et le Vatican, avec ses évêques, il y a une visibilité sociale et institutionnelle du catholicisme romain. Il est vrai que nos grands principes dominés par le sola gratia ont une dimension réflexive et intérieure qu’il est difficile d’illustrer par les moyens modernes de communication. Raison de plus, hélas, pour regretter de ne voir quasiment jamais un protestant, fidèle ou pasteur, sur les plateaux de télévision où nous aurions pourtant, bien souvent, une parole originale à faire entendre dans les débats religieux et sociétaux actuels
Pour faire un don, suivez ce lien
 Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté
Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté