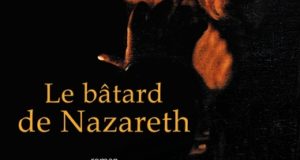Les médias nous submergent en permanence des affaires de justice et des condamnations qui en découlent. Sur ce thème, des films sortent et la télévision passe des séries. Nous nous trouvons devant une avalanche qui peut nous perturber. En matière de cinéma, le cinéphile aura vite fait de se départir des films sans intérêt, souvent commerciaux, pour penser à des chefs-d’oeuvre trop souvent oubliés. C’est le cas du Procès d’Orson Welles.
Les médias nous submergent en permanence des affaires de justice et des condamnations qui en découlent. Sur ce thème, des films sortent et la télévision passe des séries. Nous nous trouvons devant une avalanche qui peut nous perturber. En matière de cinéma, le cinéphile aura vite fait de se départir des films sans intérêt, souvent commerciaux, pour penser à des chefs-d’oeuvre trop souvent oubliés. C’est le cas du Procès d’Orson Welles.
Avec la maîtrise qui le caractérise, Welles a adapté le roman de Kafka à l’écran, scrupuleusement, retranscrivant à l’identique nombre de ses détails, mais en même temps en se le réappropriant pour échapper à une plate illustration, sans que cela signifie trahison. Le thème était de plus en résonance avec sa vie intime. Il trouvait dans le roman de Kafka des échos très proches de ses angoisses sociales et politiques, et également un traitement précis d’un sujet qui l’obsédait, celui de la culpabilité. Il dit : « Je voulais peindre un cauchemar très actuel, un film sur la police, la bureaucratie, la puissance totalitaire de l’Appareil, l’oppression de l’individu dans la société moderne. » C’était en 1962 !
Nous suivons les péripéties de Joseph K. arrêté sans savoir pourquoi et qui s’enfonce chaque jour de plus en plus profondément dans un tourbillon qui semble tout emporter : sa raison, la logique du monde, les certitudes, les notions même d’espace et de temps. Sous le coup des angoisses et d’une culpabilité avérée ou non, son univers mental se transforme en un vrai cauchemar. Incapable de prendre à bras-le-corps son procès, il s’enferre dans une succession de mensonges qu’il s’attribue en attendant que le tribunal statue. C’est terrifiant et pourtant bien réel : parfois le sentiment de culpabilité, même s’il n’est pas justifié, peut placer l’individu dans une situation désespérée. Ce qui intéresse Welles, tout comme Kafka, n’est pas l’innocence ou la culpabilité réelle de K., mais bien sa transformation suite à l’accusation, la culpabilité qu’il ressent, quels que soient les actes qu’il a ou n’a pas commis. Le Procès est emblématique de l’oeuvre du cinéaste par sa relation à une certaine modernité, liée à la naissance de l’individualité dans la crise de la Renaissance et à la tragédie shakespearienne qu’il transcrit en portant Macbeth et Othello à l’écran ; dans F for Fake, il montre que le devenir est obsolète ou disparaît dans le monde de la communication de masse d’une société où la vérité est insaisissable.
La mise en scène, stupéfiante, met le spectateur dans la situation même de l’intéressé. Elle joue sur la topographie ; la gare d’Orsay en est la partie centrale avec les heures d’attente des voyageurs, ce qui entre en parfaite résonance avec les espérances déçues des accusés qui voient dans un procès leur vie s’échapper, dans l’attente d’une chimérique décision du tribunal. Les décors confinés, sources de claustrophobie, multiplient l’angoisse de K. qui se fait de plus en plus oppressante ; ils l’enferment dans un univers empreint d’expressionnisme : plafonds bas, couloirs étroits, atelier sinistre. Les travellings et les panoramiques d’abord lents s’accélèrent et se morcellent au fur et à mesure de la plongée de K. La profondeur de champ permet de multiplier les actions dans un même plan jusqu’à perdre K. et le spectateur dans une profusion d’informations et de sens. La bande-son souligne les voix : celle de K. qui bafouille, bégaye, fait des lapsus, et les voix immuables et fermes de la justice.
Le Procès, une pierre angulaire incontournable du cinéma, est une oeuvre d’une beauté saisissante, à la fois angoissante et grisante. Elle traite d’un problème hélas toujours d’actualité avec un pessimisme que nous ne partageons pas. La Parole n’est-elle pas source d’espérance et de lumière dans un univers qui nous paraît sans elle absurde et inextricable ?
Pour faire un don, suivez ce lien
 Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté
Évangile et Liberté Penser, critiquer et croire en toute liberté